Labellisation chapeau de Saponé : les artisans fabricants en attendent une meilleure rémunération
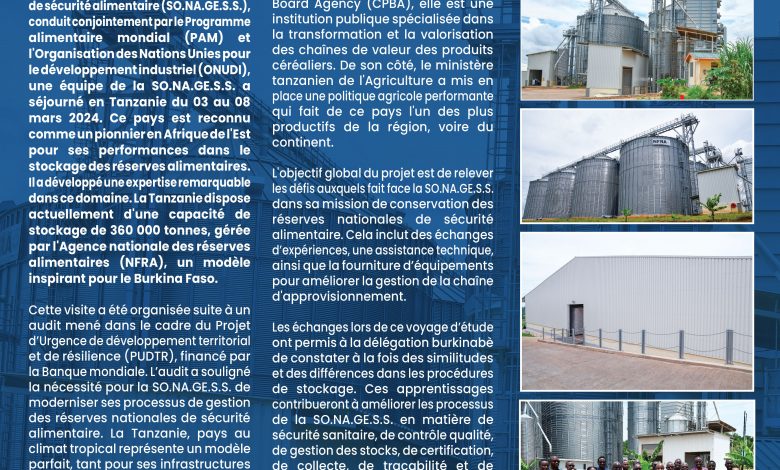
Plus qu’une œuvre d’art, le chapeau de Saponé est devenu un héritage culturel et une importante source de revenus pour les hommes et femmes qui interviennent dans sa fabrication. Regroupés au sein de la société coopérative des producteurs du chapeau de Saponé, ils ont fait preuve d’une joie non dissimulée lors de la cérémonie de dévoilement du label.

Pour connaître l’origine du chapeau de Saponé, il faut remonter vers l’an 1358. En effet, c’est à cette époque que Naaba Kouda, fils du chef mossi Naaba Koumdoumié, décida d’aller combattre des envahisseurs du royaume alors qu’il était sur le point de se faire introniser. Le conseil des notables envoya alors des troupes à sa recherche. L’ordre fut donné de lui raser la tête (qui signifie en mooré sâ-n-poné, devenu Saponé de nos jours) à l’endroit où on le retrouverait. « Naaba Kouda, une fois rasé, demanda un chapeau pour se couvrir la tête », explique Naaba Sigri de Saponé. Selon d’autres témoignages, le chef traditionnel aurait fabriqué lui-même ce chapeau pour cacher sa tête rasée qui a fini par devenir un héritage culturel et un symbole de solidarité. Il aurait même exhorté ses sujets à affiner et à maîtriser sa confection car ils finiraient un jour par en manger le fruit.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce vœu est devenu réalité. En effet, cette œuvre d’art offert à plusieurs chefs d’Etat (comme le président Paul Kagamé du Rwanda) lors des visites officielles, représente aujourd’hui une importante source de revenus pour les hommes et femmes exerçant soit dans le tissage, la fourniture des fibres de Raphia soudanica (matière première) et de peaux, la décoration et la commercialisation. C’est du moins ce qu’a déclaré Assèta Kaboré, la porte-parole des femmes de la société coopérative mise en place avec l’accompagnement de Naaba Sigri.
lire aussi valorisation des produits du terroir : Harouna Kaboré dévoile le label du « zougpeogo »
Mère de trois enfants, Nadège Ouédraogo, une autre membre de la coopérative ne dit pas le contraire. Elle fait partie du groupe de femmes qui tissent le chapeau pour le revendre aux hommes qui se chargent de l’embellir avec le cuir et toutes sortes de décorations. « Le prix varie de 2 000 à 2 500 francs CFA », nous confie-t-elle avant d’ajouter : « Avec l’argent que nous gagnons, nous aidons nos maris à inscrire nos enfants à l’école et à veiller au bien-être de toute la famille ».

Installé sous la tente voisine, Yacouba Bélem est occupé à poser le cuir sur un lot de chapeaux tissés par les femmes. Ce métier, il le fait depuis 13 ans. Visiblement très ému, il a du mal à exprimer la fierté qu’il ressent de voir les autorités s’impliquer autant dans leur travail. « Cette initiative va donner de la valeur à ce que nous faisons », ne manque-t-il pas d’affirmer. Interrogé sur les prix, l’homme qui a déjà atteint un certain âge, restera un peu vague. Selon lui, tout dépend de la qualité et des décorations posées sur le chapeau. Cependant, le moins cher, le petit modèle en l’occurrence, coûte 2000 F CFA. Après un petit tour des stands, on s’aperçoit effectivement que les prix affichés sont différents d’un chapeau à l’autre, variant de 8 000 à 10.000 pour les plus grands. Certains en ont profité pour faire de bonnes affaires en espérant qu’ils pourront désormais écouler facilement leurs marchandises après les mesures annoncées par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré.
En effet, jusque-là, certains producteurs devaient se rendre personnellement à Ouagadougou pour la vente.
Zalissa Soré

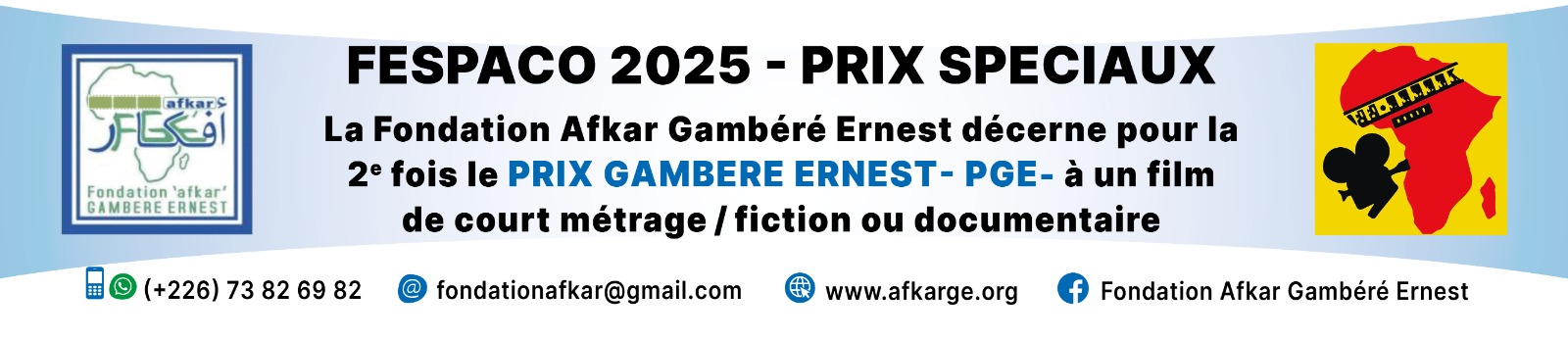

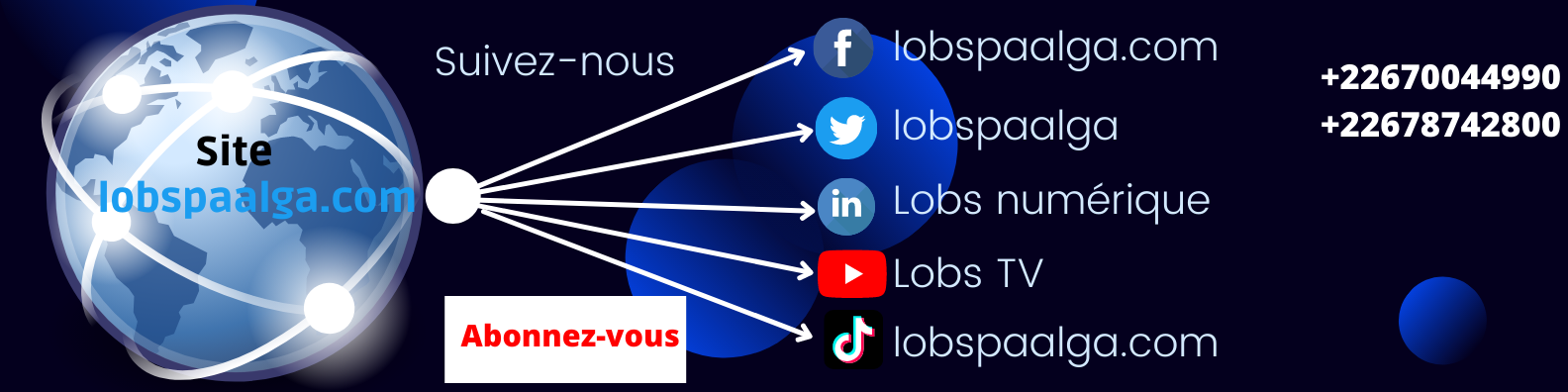
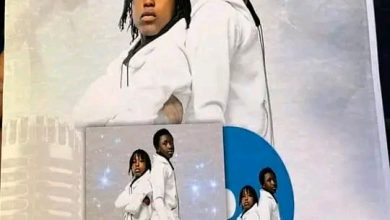

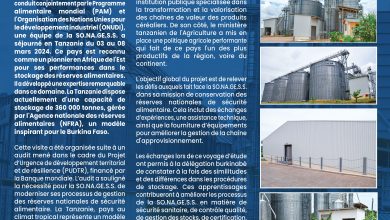

félicitation