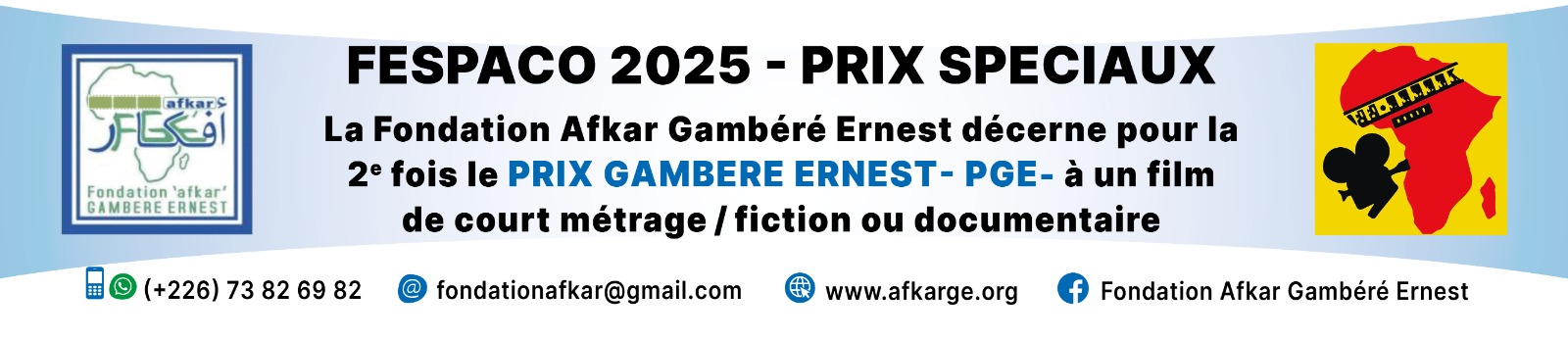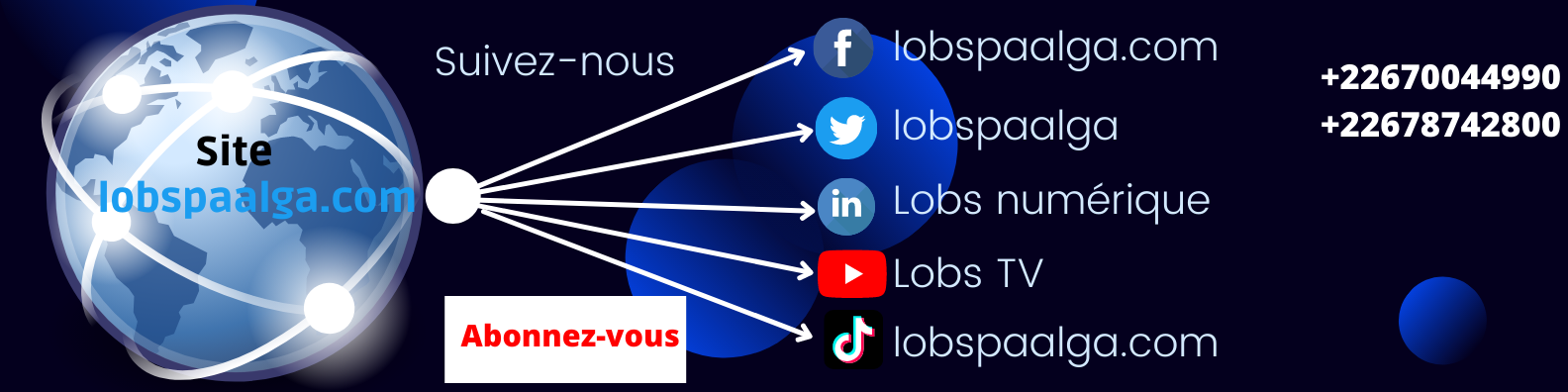Djihadisme : « Cet islam, nous le combattons », Bilal Ramadan
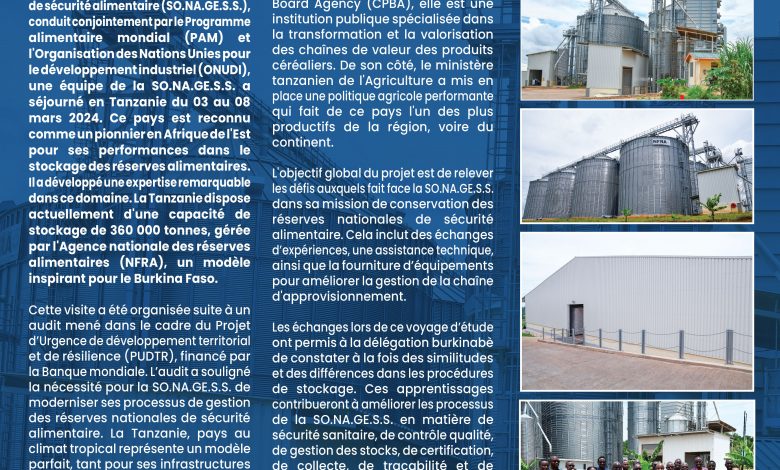
Sur demande du Centre Valère Somé pour l’innovation politique, le philosophe et formateur Bilal Ramadan a animé une conférence publique sur le thème « islam, Islamophobie et terrorisme ». C’était dans l’après-midi du mardi 21 septembre 2021 à Ouagadougou.

Y a-t-il un lien entre islam, islamophobie et terrorisme ? Telle est la question qui trottait sans doute dans l’esprit de ceux qui ont fait le déplacement au Centre de presse Norbert Zongo. Mais avant d’en venir à ce point, le conférencier a d’abord pris le temps de développer, l’un après L’autre, les trois concepts.
En effet, pour Bilal Ramadan, l’islam est avant tout une religion de paix qui est pratiquée par près de deux milliards de personnes à travers le monde. « Pour moi, il se définit comme une religion d’amour et de liberté », a-t-il déclaré, précisant qu’on ne peut pas condamner tous les musulmans pour le fait de quelques groupes.
Dans son développement, le philosophe a fait savoir que l’islamophobie qui désigne, selon le dictionnaire, l’hostilité envers l’islam et les musulmans, est un grand problème qui existe dans le monde occidental, notamment en France où les mahométans luttent pour faire valoir leur droit à la double identité musulmane et française. Leur objectif, que la France dont la devise est Liberté-Egalité-Fraternité, admette qu’une personne peut à la fois être musulmane, laïque et démocrate. « Une limite rouge a été franchie avec la fermeture du CCIF (Collectif contre islamophobie en France) et d’une maison d’édition sous prétexte qu’elle éditait des livres au penchant musulman et qui dénonçait l’homosexualité », a déploré le frère de Tariq Ramadan, ajoutant que la situation a atteint un stade extrême. Et s’il y a une chose que le conférencier trouve particulièrement cruelle, c’est le fait que, selon lui, le monde occidental dise que l’origine de sa civilisation remonte à la Mésopotamie, oubliant ainsi six à huit siècles de civilisation musulmane qui lui ont permis d’atteindre le siècle des Lumières. De son point de vue, cette injustice faite à l’islam, en le rayant de ce passé est très grave.

Quant au terrorisme, le philosophe et formateur qui vit en Suisse mais qui a des origines égyptiennes estime que c’est une erreur de faire croire qu’il a commencé avec les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. « Ce phénomène existe depuis plus longtemps que cela et beaucoup l’on utilisé », a-t-il soutenu. La seule question qu’il faut se poser c’est de savoir si l’islam l’accepte ou le refuse, dira Bilal Ramadan avant d’argumenter : « L’islam est une religion de justice qui ne va jamais cautionner cette pratique. Aucun imam, aucun intellectuel n’a le droit de l’approuver. Ce serait une erreur grave et une trahison ». Si le conférencier peut aisément comprendre que des personnes sans culture et sans raisonnement pensent qu’elles peuvent réussir leur projet en semant la terreur, lui estime au contraire que ce n’est pas cela l’islam. Il a aussi invité les musulmans à dénoncer le terrorisme et à comprendre que très souvent il fait plus de mal aux fidèles croyants qu’aux autres. « Cet islam, nous le combattons », a-t-il conclu.
Face à l’insistance du public à établir un lien entre le terrorisme et l’islam, Newton Ahmed Barry qui a joué le rôle de modérateur, a pris la parole pour apporter quelques précisions, expliquant que la religion n’est pas toujours le premier élément pris en compte dans le recrutement des terroristes. Pour cela, il a pris l’exemple de Malam Dicko, qui, dans le Soum, a recruté des soldats parmi trois communautés : il s’agit d’abord des Rimaïbé qui étaient considérés comme les esclaves des autres. C’est la frustration ressentie par les jeunes générations qui a favorisé cela ; il y a aussi le groupe des personnes frustrées du fait que l’islam était monopolisé par des familles, ce qui ne leur permettait pas d’avoir un statut tant qu’elles ne descendent pas directement de ces familles ; la troisième vague, c’est ceux qui sont déçus par l’administration publique, sa corruption et sa brutalité.
Zalissa Soré